Du MEXIQUE au BRÉSIL au temps des dictateurs et du dollar
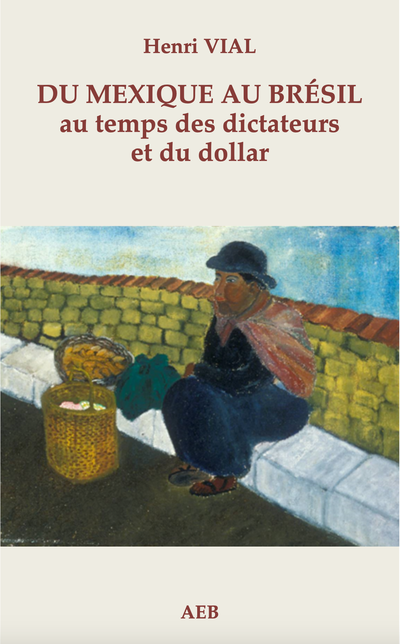
Juillet 2020
Amérique latine
Un routard
en pays de policiers
et de guérillas
Chroniques de voyage, 1968
Le 1er juillet 1967 – en pleine guerre froide opposant les États-Unis à Cuba et à l’URSS – Henri Vial, étudiant en philosophie de 23 ans à l’Université de Lyon, « désireux de confronter la culture universitaire à la réalité vivante », effectue un périple de 9 mois qui le conduit, sac au dos, des USA au Brésil, à travers une Amérique latine où dollar et CIA gouvernent, et où sévissent régimes autoritaires et dictatures militaires, auxquels résistent des guérillas sévèrement réprimées mais bien vivaces, dans un contexte de profonde misère, notamment des peuples indiens dépossédés. En contact avec le quotidien des rues et des campagnes, le globe-trotter raconte la vie de tous les jours et les tribulations d’un solitaire confronté à ses propres angoisses, dans un monde de policiers omniprésents, mais aussi de religiosité exacerbée et de plantes psychédéliques, autant que de rencontres colorées et de petits bonheurs.
L'Amérique latine de la guerre froide... Les missionnaires qui prient pour les miséreux tout en roulant en cadillac
Le Monde diplomatique
Échos
![]() Le Monde diplomatique juillet 2021 p.24 (Les blogs du Diplo, Les livres du mois, août 2021, p. 24)
Le Monde diplomatique juillet 2021 p.24 (Les blogs du Diplo, Les livres du mois, août 2021, p. 24)
![]() Nathalie Lescop-Boesswillwald - Les Amis de Thalie - Septembre 2020 p. 65-66
Nathalie Lescop-Boesswillwald - Les Amis de Thalie - Septembre 2020 p. 65-66
![]() Béatrice Gaudy - Une invitation au voyage - Décembre 2020
Béatrice Gaudy - Une invitation au voyage - Décembre 2020

